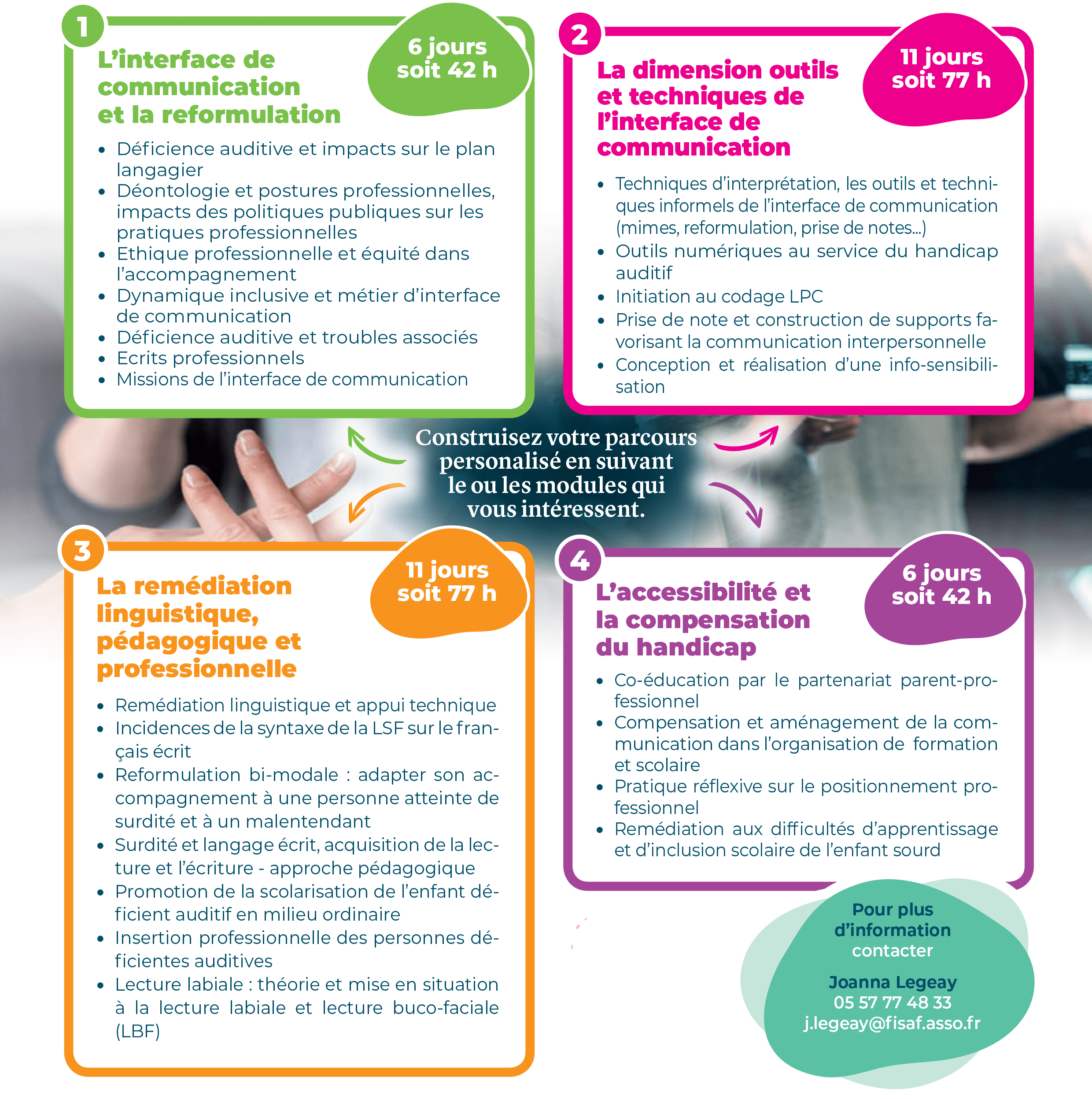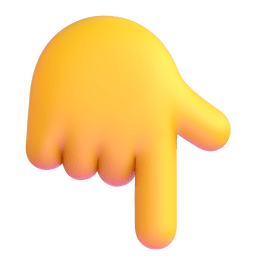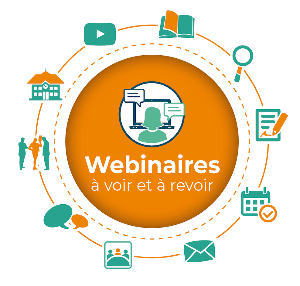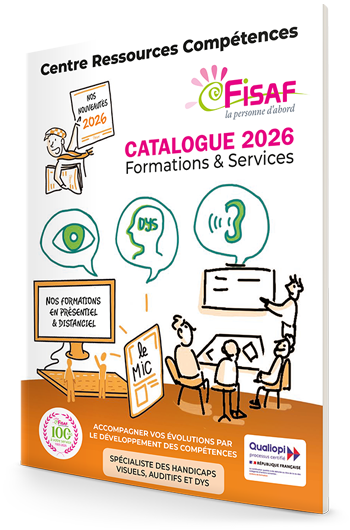Les interfaces de communication sont des professionnels spécialisés dans la médiation langagière et culturelle. Leur mission principale est d’accueillir et d’accompagner les personnes sourdes ou malentendantes, en facilitant leur inclusion dans la société.
Contrairement aux interprètes en langue des signes française (LSF) ou aux traducteurs, les interfaces de communication n’assurent pas une traduction stricto sensu. Leur rôle est d’assurer la compréhension mutuelle entre les interlocuteurs en adaptant leur mode de communication à la situation et aux besoins de la personne accompagnée.
Selon les contextes, ils peuvent utiliser différents moyens de communication : LSF, Langue française Parlée Complétée (LfPC), français signé, dessins, mimes, lecture labiale, français écrit, etc.
En plus de cette mission d’accompagnement, les interfaces peuvent également jouer un rôle de sensibilisation à la surdité et à la diversité des modes de communication.
Comme tout professionnel de la communication, ils respectent un cadre déontologique fondé sur trois principes essentiels :
- La fidélité : transmettre le message dans son intégralité, en respectant le fond et l’intention.
- La neutralité : ne pas influencer les échanges, ni exprimer d’opinion personnelle.
- Le secret professionnel : garantir la confidentialité des informations partagées.
Les interfaces de communication exercent principalement dans des structures médico-sociales (comme les SAVS – Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) ou au sein d’associations telles que les URAPEDA.